
|
|
Support de cours Réseaux EISTI |
|
Que signifie réseau
Un réseau en général est le résultat de la connexion
de plusieurs machines entre elles, afin que les utilisateurs et les applications
qui fonctionnent sur ces dernières puissent échanger des
informations.
Le terme réseau en fonction de son contexte peut désigner plusieurs
choses. Il peut désigner l'ensemble des machines, ou l'infrastructure
informatique d'une organisation avec les protocoles qui sont utilisés,
ce qui 'est le cas lorsque l'on parle de Internet.
Le terme réseau peut également être utilisé pour
décrire la façon dont les machines d'un site sont
interconnectées. C'est le cas lorsque l'on dit que les machines d'un
site (sur un réseau local) sont sur un réseau Ethernet, Token
Ring, réseau en étoile, réseau en bus,...
Le terme réseau peut également être utilisé pour
spécifier le protocole qui est utilisé pour que les machines
communiquent. On peut parler de réseau TCP/IP, NetBeui (protocole
Microsoft) DecNet(protocole DEC), IPX/SPX,...
Lorsque l'on parle de réseau, il faut bien comprendre le sens du mot.
Pourquoi des réseaux
Les réseaux sont nés d'un besoin d'échanger des informations
de manière simple et rapide entre des machines. Lorsque l'on travaillait
sur une même machine, toutes les informations nécessaires au
travail étaient centralisées sur la même machine. Presque
tous les utilisateurs et les programmes avaient accès à ces
informations. Pour des raisons de coûts ou de performances, on est
venu à multiplier le nombre de machines. Les informations devaient
alors être dupliquées sur les différentes machines du
même site. Cette duplication était plus ou moins facile et ne
permettait pas toujours d'avoir des informations cohérentes sur les
machines. On est donc arrivé à relier d'abord ces machines
entre elles; ce fût l'apparition des réseaux locaux. Ces
réseaux étaient souvent des réseaux "maisons" ou
propriétaires. Plus tard on a éprouvé le besoin
d'échanger des informations entre des sites distants. Les réseaux
moyenne et longue distance commencèrent à voir le jour. Ces
réseaux étaient souvent propriétaires. Aujourd'hui,
les réseaux se retrouvent à l'échelle planétaire.
Le besoin d'échange de l'information est en pleine évolution.
Pour se rendre compte de ce problème il suffit de regarder comment
fonctionnent des grandes sociétés. Comment pourrait-on
réserver une place de train dans n'importe quelle gare? Sans échange
informatique, ceci serait très difficile, voire impossible.
Pourquoi une normalisation
Si chacune des personnes (physiques ou morales) ne devait échanger
des informations qu'avec des gens de sa communauté, alors il n'y aurait
pas besoin de normalisation, chaque entité pourrait échanger
ces informations avec des membres de la même entité. Il suffirait
que chacune des personnes utilise le même "langage" (protocole) pour
échanger ces informations.
Malheureusement (?), de plus en plus d'entité on besoin d'échanger
des informations entre elles (SNCF, agence de voyage, organisme de recherche,
école, militaires, ...). Si chacune de ces entités utilise
son réseau (au sens protocole) pour que ces entités puissent
communiquer ensemble il faudrait chaque fois réinventer des moyens
pour échanger l'information. C'est ce qui se faisait au début.
Des gens ont eu l'idée de réfléchir à ce
problème et ont essaye de recenser les différents problèmes
que l'on trouvait lorsque que l'on veut mettre des machines en réseau.
De cette réflexion est sortie le modèle OSI de l'ISO.
|
Pour faire circuler l'information sur un réseau on peut utiliser
principalement deux stratégies. L'information est envoyée de façon complète. L'information est fragmentée en petits morceaux (paquets), chaque paquet est envoyé séparément sur le réseau, les paquets sont ensuite réassemblés sur la machine destinataire. Dans la seconde stratégie on parle réseau à commutations de paquets. La première stratégie n'est pas utilisée car les risques d'erreurs et les problèmes sous-jacents sont trop complexes à résoudre. Le modèle OSI est un modèle à 7 couches qui décrit le fonctionnement d'un réseau à commutations de paquets. Chacune des couches de ce modèle représente une catégorie de problème que l'on rencontre dans un réseau. Découper les problèmes en couche présente des avantages. Lorsque l'on met en place un réseau, il suffit de trouver une solution pour chacune des couches. L'utilisation de couches permet également de changer de solution technique pour une couche sans pour autant être obligé de tout repenser. Chaque couche garantit à la couche qui lui est supérieur que le travail qui lui a été confié a été réalisé sans erreur. |
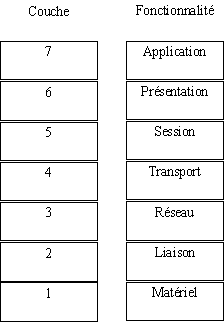
|
Dans cette couche, on va s'occuper des problèmes strictement matériels. (support physique pour le réseau). Pour le support, on doit également préciser toutes ces caractéristiques.
Pour du câble :
Pour des communications hertziennes
Fibre optique
|
Chaque machine est reliée à toutes les autres par un câble. |
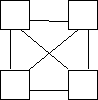
|
|
Chaque machine est reliée à un câble appelé bus. |
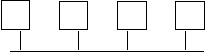
|
|
Chaque machine est reliée à une autre de façon à former un anneau |

|
Lorsqu'une machine veut émettre un message sur le bus à destination
d'une autre, la première commence par "écouter" le câble
(CS). Si une porteuse est détectée, c'est que le bus est
déjà utilisé. La machine attend donc la fin de la
communication avant d'émettre ses données. Si le câble
est libre, alors la machine émet ses données. Durant
l'émission la machine reste à l'écoute du câble
pour détecter une collision (CD). Si une collision est
détectée, chaque machine qui émettait suspend
immédiatement son émission et attend un délai
aléatoire tiré entre 0 et une valeur N. Au bout du temps N
le cycle recommence. Si une seconde détection est repérée
le délai est tiré entre 0 et 2 * N. Ainsi de suite jusqu'à
16 * N. Après on recommence à N.
Chaque machine reçoit donc toutes les données qui circulent
sur le bus. C'est au niveau de la couche 2 que l'on décide de garder
les données ou de les jeter.
Avantages et
inconvénients
Le câblage en maile n'est plus utilisé car trop coûteux
en câble.
De part son architecture, le câblage en bus avec des protocoles CSMA/CD
convient très mal dans un environnement temps réel. Sur un
réseau en bus, deux machines peuvent monopoliser le câble.
L'architecture en anneau avec un protocole à base de jeton, peut servir
dans un environnement temps réel car le délai maximum pour
transmettre une information entre 2 machines peut être calculé.
Le câblage en anneau nécessite plus de câble puisqu'il
faut reboucler la dernière machine sur la première. Le
câblage en anneau peut être perturbé par la panne d'une
seule machine.
Dans une étoile, le point faible est le centre de l'étoile,
si cet élément tombe en panne, alors tout le réseau
est paralysé.
Techniques de
câblage actuelles
|
De plus en plus on revient à un câblage qui ressemble à première vue à un câblage en étoile. |
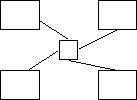
|
Chaque machine est reliée par un câble à un appareil
actif. Ce type de câblage peut être utilisé dans une
architecture réseau de type bus ( Ethernet XXX BT). L'élément
actif recopie alors l'information sur chacun des câbles. Dans une
architecture de type anneau l'appareil réemet les informations sur
un seul câble à la fois.
Cette architecture est plus sécurisée, car si une station tombe
en panne (ou si son câble est défectueux), l'élément
actif peut "désactiver" la ligne en défaut.
Le seul rique reste au niveau du centre de l'étoile. Ce rique est
limité, car le matériel est de plus en plus résistant.
Ce type de câblage est répendu car il permet d'utiliser les
cables tirés par les téléphonistes.
|
|
Support de cours Réseaux EISTI |
|